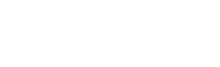Article paru dans Le Monde le Jeudi 22 mai 2025
à retrouver sur le journal ici Par Stéphane Davet et Laure Gasparotto
Des vins à boire avec les yeux
Comparé à l’odorat et au goût, la vue est le sens sur lequel on s’attarde le moins, lors d’une dégustation. L’aspect du vin, riche d’une palette infinie de nuances, fournit pourtant des informations essentielles. Où le journaliste parle de Gilles de Revel, professeur d’oenologie à l’institut des sciences de la vigne et du vin à l’université de Bordeaux, qui a mis en place un enseignement consacré à la couleur du vin.
« Belle robe vermeille, un peu violette. Bel éclat. C’est un bordeaux… un grand bordeaux ! » Qui ne connaît pas cette scène culte de L’Aile ou la Cuisse (1976), réalisé par Gérard Oury ? Privé du goût et de l’odorat par l’infâme Tricatel (joué par Julien Guiomar), le critique gastronomique Duchemin (Louis de Funès) compense : rien qu’à la robe du vin, il devine son origine. « C’est un saint-julien. Château Léoville Las Cases 1953 ! »
Certes la comédie pousse loin le bouchon, mais les couleurs des vins restent une source fascinante d’indices. Elles peuvent nous renseigner sur le ou les cépages utilisés, le type de vinification, le millésime, le sol, le climat…
« J’arrive à détecter la qualité d’un vin rien qu’en le regardant », reconnaît Jean-Claude Mas, oenologue et négociant dans le Languedoc. Quand il travaille à un assemblage, la couleur lui indique immédiatement s’il est réussi ou non : terne, il faut recommencer ; vibrante avec des nuances, l’assemblage est réussi.
« A l’oeil, on voit si un vin est complexe ou pas. La couleur dit son élégance, sa jeunesse, mais aussi son rendement et la maturité de ses fruits, poursuit-il. En vendangeant plus tard, le fruit se concentre et on obtient plus de densité chromatique. D’un autre côté, plus on a un rendement élevé, plus la couleur finale sera diluée et donc claire. » Par ailleurs, plus un blanc est nuancé, doré ou avec des reflets, plus il exprime son terroir et son identité.
Une pulpe incolore
Si une combinaison complexe de facteurs définit la couleur d’une cuvée, la variété des raisins et leur processus de vinification sont les deux éléments qui l’emportent sur le reste. On dénombre traditionnellement trois catégories de couleur : les rouges, les blancs et les rosés. Même si une quatrième tente de compléter le tableau de façon officieuse. Cette place est tantôt attribuée aux vins orange (vins blancs de macération), aux vins jaunes (vins de voile du Jura), voire aux blouges (vins mélangeant cépages blancs et noirs).
Pour rappel, on élabore un vin rouge à partir de raisins noirs (cabernet franc, pinot noir, grenache, syrah…), dont le jus et les peaux macèrent ensemble de quelques jours à quelques semaines. A l’exception des très rares cépages dits « teinturiers », comme l’alicante, la pulpe des raisins est incolore.
Ce sont les pigments (des polyphénols appelés « anthocyanes ») contenus dans les peaux qui colorent le jus. Les vins blancs sont quant à eux produits avec des raisins blancs (sauvignon, chardonnay, chenin, riesling…) pressés directement : le moût est rapidement séparé des peaux, afin de limiter leur contact avec les polyphénols propres aux raisins blancs, les flavonoïdes.
Orange, « la couleur du vin du futur »
Lorsqu’un processus de macération est appliqué à ces raisins, le jus se teinte d’ambre, d’or ou d’abricot. C’est le fameux vin orange. « La couleur du vin du futur », selon Christophe Lavelle, biophysicien spécialiste de l’alimentation, chercheur au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle, et auteur du livre A la découverte des vins géorgiens (Apogée, 2023). « En faisant macérer les vins blancs comme des rouges, ils deviennent orange mais aussi plus riches en polyphénols, précise le scientifique. Ils ont un atout supplémentaire, un goût hybride qui offre une plus large possibilité d’accords. »
Quant aux rosés, deux processus permettent de les obtenir, chacun à partir de raisins noirs. Le premier, dit de « pressurage », consiste à presser lentement les grappes sans macération préalable, le temps que les peaux teintent le jus d’une légère couleur rosée. Le second, dit « de saignée », consiste à faire macérer les moûts avec les peaux, puis à interrompre la macération avant que les jus ne deviennent rouges. « Une monochromie du rosé clair impulsée par la Provence s’est peu à peu imposée, loin du rosé historique soutenu. Dès lors, un rosé trop coloré va aujourd’hui être considéré comme sucré, tandis qu’un rosé pâle comme sec, voire très sec », selon Jean-Claude Mas.
A l’intérieur même de ces différentes catégories existent de multiples variations de teintes, offrant un « Pantone oenologique » infini. Il est d’ailleurs intéressant de noter que de nombreuses nuances sont directement issues du lexique vinicole : bordeaux, lie de vin, bourgogne, etc. Dans le livre Vinocolor. Nuancier des couleurs du vin (Kéribus, 2024), Victor Coutard, Matthieu Le Goff, Gala Colette et Paul Lehr ont photographié et classé par ordre d’intensité croissante les robes de 120 cuvées. Des vins avec peu ou pas de produits chimiques, originaires de quinze pays différents, qui vont du « vert anisé au presque noir, en passant par le rubis, l’ambre ou l’or ».
Avec originalité et poésie, chaque teinte a été baptisée (vinvert, palmento, soulier, rose fontaine, rouge tempête, rouge adieu…), mais aussi analysée et chiffrée selon des codes colorimétriques utilisés en imprimerie (CMJN) et en informatique (RVB). Après le tastevin, petite tasse métallique apparue au XVIIe siècle, puis le vino-colorimètre, un ruban de soie de différentes nuances conçu au XIXe siècle par Jules Salleron, c’est la précision numérique du spectrophotomètre qui mesure désormais cette palette chromatique.
Limpidité, brillance, viscosité
Aux données chiffrées, Florence de La Rivière préfère le partage des mots. Longtemps peu familière des métiers du vin, cette designer coloriste a été contactée en 2009 par Gilles de Revel, professeur d’oenologie à l’institut des sciences de la vigne et du vin à l’université de Bordeaux, pour mettre en place un enseignement consacré à la couleur du vin. « Gilles avait fait le constat que la vue était devenue l’enfant pauvre de la dégustation, se souvient Florence de La Rivière. Les chiffres des sciences oenologiques se sont substitués à l’analyse sémantique de la couleur. Un paradoxe dans une société dominée par le visuel. »
Son but : « Permettre aux dégustateurs et aux vignerons d’élargir leur lexique chromatique pour que leur mémoire visuelle soit à la hauteur de leur mémoire olfactive et gustative. » Plusieurs années de travail et de cours ont donné naissance à un livre passionnant, L’oeil du vin. Lire les couleurs du vin (Editions de La Martinière, 2024), coécrit avec Bénédicte Bortoli et illustré de magnifiques photos de Jérôme Bryon.
Les autrices y déclinent, entre autres, les caractéristiques de « l’aspect physique du vin », qu’il s’agisse de sa limpidité, sa brillance, sa viscosité ou des « larmes » qu’il laisse glisser le long du verre. Elles décryptent « l’intensité colorante » (de la clarté à la saturation) et les teintes, autant que ce dont celles-ci peuvent être le signe, informant sur les cépages (de l’encre du petit verdot au grenat du poulsard et du nebbiolo, du pourpre de la syrah à la densité nocturne du tannat, en passant par les reflets verts du sauvignon), la zone géographique, le terroir ou encore la climatologie (les vignes d’une vallée fraîche donnent souvent des vins plus clairs que celles exposées plein sud sur un sol caillouteux emmagasinant la chaleur).
Les rouges perdent en intensité
Enfin, les couleurs ne sont pas fixes, elles suivent la vie du vin et évoluent avec le temps. Soumis aux effets de l’oxydation, les rouges perdent en intensité et tirent vers le brun ou le fauve, tandis que les blancs prennent des teintes dorées. « En général, le passage du registre des ors à celui des ambres marque la fin de l’apogée d’un blanc sec », précise Florence de La Rivière. Même si le monde des vieux millésimes réserve de très belles surprises dès qu’on s’aventure dans certains domaines. « Les grands vins gardent très longtemps leur couleur d’origine », assure François Audouze, ancien industriel de la métallurgie, devenu en trente ans l’un des plus grands collectionneurs mondiaux de vins anciens.
Il se souvient d’un Château Latour centenaire qui n’était pas encore « tuilé ». « Un vin un peu terreux n’est pas pour autant altéré », ajoute-t-il en citant l’exemple d’un chambertin 1928. Son secret : l’oxygénation lente avec « une ouverture du bouchon quatre heures avant ». Surtout pas de carafage, qui verrait s’évanouir saveurs et couleur. Même les blancs peuvent résister. « Les grands pessac-léognan ne s’assombrissent quasiment jamais », insiste-t-il en prenant l’exemple de la robe limpide d’un Château Laville Haut-Brion 1947.
L’évolution des grands sauternes vers des teintes de plus en plus ambrées n’est pas moins gage d’éternité. « Les années les plus riches en botrytis [un champignon qui favorise la concentration des jus dans les vins liquoreux] produiront les vins les plus sombres, à l’instar de ce Château Yquem 1921 à la robe presque noire et aux saveurs caramélisées. »
Des critères qui évoluent au fil du temps
Selon les époques, les grilles de lecture des couleurs peuvent changer. Sous l’influence du critique américain Robert Parker, une coloration intense ou foncée pouvait être, dans les années 1990, une référence de qualité et d’aptitude au vieillissement. Or, ces vins souvent bodybuildés par des élevages poussés étaient des leurres : beaucoup se sont révélés des sprinteurs qui se sont rapidement écroulés. Aujourd’hui, bien qu’elle soit toujours plébiscitée dans certains pays, notamment aux Etats-Unis, la robe noire d’un vin est plutôt synonyme de lourdeur pour des consommateurs cherchant désormais une légèreté qu’ils croient deviner dans des rouges aux teintes plus claires.
A une époque où de plus en plus de consommateurs sont en quête de vins « libres » et « vivants », ces critères chromatiques ne font plus l’unanimité. « Il y a quelques années, il y avait un diktat selon lequel si un vin n’avait pas de couleur, c’est qu’il était raté, se souvient Bruno Quenioux, fondateur de la cave parisienne PhiloVino. Or, certains vins sont clairs par nature, comme les rouges du Jura, car ils sont faits avec des trousseaux et des poulsards, des cépages plus scintillants que colorés. A contrario, un côte-rôtie peut avoir de la couleur en même temps que de la clarté et ne doit pas forcément être sombre pour être grand. »
Le terroir a un impact sur la robe du vin, mais il faut aussi prendre en compte le savoir-faire du vigneron. Par exemple, l’absence de filtration, de plus en plus répandue aujourd’hui, peut provoquer une turbidité, synonyme de défaut pour certains, mais assumée dans l’univers des vins nature. « Lors des vinifications en amphore, les lies de ces vins non filtrés auront tendance à rester un peu en suspension, d’où un léger trouble », explique Thierry Puzelat, du Clos du Tue-Boeuf, aux Montils (Loir-et-Cher). « Elevés en fûts, ces vins se décantent beaucoup mieux », précise le vigneron, en soulignant craindre les bactéries et les arômes réducteurs souvent associés à la turbidité. « Je préfère tout de même avoir les vins les plus limpides possibles, même si certains de nos clients vont trouver cette clarté suspecte. »
La légèreté est une vibration
Plus que la teinte, mieux vaut voir ressortir la lumière d’un vin, celle que la technologie ne peut mesurer. Bruno Quenioux a ainsi constaté que ses clients sont devenus sensibles à la brillance, au côté éclatant d’un vin plus qu’à sa densité. « Certains vins révèlent leur terroir autrement que par leur couleur prononcée. Les rouges denses ont fait beaucoup de mal au monde du vin en général. Aujourd’hui, il y a une appétence pour la légèreté de la couleur, que l’on associe aux vins glouglou. Or, la légèreté est une vibration qui vient du terroir. »
Encore trop peu exploré lors des dégustations, l’aspect visuel mériterait d’être au moins autant pris en compte que les arômes et les saveurs. C’est aussi l’avis de Jean-Claude Mas : « Donner plus de nuances au vin permet aussi de le rendre plus ludique, plus intéressant et plus approprié aux nuances de l’assiette. C’est une des raisons pour lesquelles je travaille de plus en plus sur la macération des vins blancs vers des teintes orangées ou ambrées », reconnaît-il. Et si l’attachement à l’éclat, la brillance, la tonalité, la nuance d’un vin permettait de redonner un peu de couleur à une filière dont l’état de santé est en demi-teinte ?